Inscrivez-vous à notre prochain Webinar « Au-delà des crypto-actifs : innovations et applications du Web3 » et à l’événement de restitution de notre grande étude annuelle à Bercy
Recherche
Tribune « Web3/Blockchain sous surveillance : quand la lutte contre le narcotrafic menace l’innovation »
Dans les prochains jours, l’Assemblée nationale débattra d’une proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic. Un objectif légitime et nécessaire. Mais une fois encore, la tentation de l’amalgame risque d’emporter un secteur stratégique dans une spirale réglementaire punitive et infondée. Loin de cibler uniquement les criminels, ce texte assimile toute utilisation des crypto-actifs à un soutien potentiel au narcotrafic, instaurant ainsi un soupçon généralisé sur l’ensemble d’un écosystème technologique.
Un amalgame dangereux et une atteinte aux droits fondamentaux
L’argument selon lequel les crypto-actifs faciliteraient massivement le financement du narcotrafic ne repose sur aucun fondement solide. Toutes les données disponibles montrent que l’argent liquide demeure le principal vecteur de ces activités illégales. Pourtant, la proposition de loi introduit une présomption de blanchiment pour toute transaction impliquant des crypto-actifs anonymisés. Ce dispositif inverse la charge de la preuve et impose aux utilisateurs de justifier l’origine légitime de leurs fonds a posteriori sous peine de sanctions.
Une telle approche heurte plusieurs principes fondamentaux du droit. D’abord, la présomption d’innocence, qui interdit d’ériger la suspicion en règle générale. Ensuite, la proportionnalité des sanctions, qui exige que toute restriction soit strictement justifiée. Enfin, l’égalité devant la loi : pourquoi les utilisateurs de crypto-actifs devraient-ils être soumis à un régime plus contraignant que les transactions en espèces, principal canal du blanchiment dans le narcotrafic ? Rappelons que le droit à la vie privée dans les transactions financières est également protégé par plusieurs textes fondamentaux, notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Compromettre l’avancement technologique et la souveraineté numérique de la France
De même, l’idée selon laquelle les crypto-actifs échapperaient à tout contrôle est une fiction. Contrairement à l’argent liquide, la blockchain est un outil de traçabilité par excellence. Chaque transaction y est enregistrée de manière indélébile et accessible. Les technologies d’analyse blockchain permettent d’identifier et de suivre les flux financiers suspects, offrant aux autorités un levier bien plus efficace que les circuits financiers traditionnels opaques. Au lieu d’exploiter ces outils pour identifier les criminels, le texte interdit des technologies qui, bien utilisées, sont précisément celles qui permettront demain une lutte plus efficace contre le blanchiment.
Restreindre l’anonymisation des transactions sans distinction entre usages licites et illicites crée un précédent dangereux. Cette approche pénalise des citoyens respectueux des lois, y compris des journalistes, lanceurs d’alerte et militants politiques dans des environnements répressifs.
Au résultat, ce texte ne protège ni les citoyens, ni l’économie mais détourne l’attention des vrais leviers de lutte contre la criminalité en affaiblissant un secteur stratégique. Si la lutte contre le narcotrafic est une priorité, elle ne doit pas aboutir à un nivellement par le bas de l’innovation numérique. En réduisant le Web 3.0 à une caricature de “no go zone”, la France s’inflige une double peine : la perte de compétitivité économique et l’affaiblissement des libertés fondamentales. Le Web 3.0 ne saurait être le bouc émissaire des dérives criminelles alors qu’il offre précisément des solutions pour mieux les combattre.
Un appel à une régulation mesurée et constructive
La France a l’opportunité de se positionner en leader européen sur ces technologies en développant un cadre réglementaire intelligent et pragmatique. Il est temps d’accompagner un écosystème déjà fortement encadré, qui ne demande qu’à se développer avec la confiance des pouvoirs publics.
Si ce texte venait à être adopté en l’état, il ne manquerait pas d’être contesté sur le terrain constitutionnel, voire devant les juridictions européennes. Une législation ne peut pas reposer sur des approximations et des amalgames : elle doit s’appuyer sur des faits objectifs et respecter les principes de notre État de droit.
Dès lors, il est impératif que les parlementaires réévaluent ce texte et adoptent une régulation proportionnée, efficace et conforme aux standards européens. Une régulation efficace repose sur une compréhension fine des enjeux et une coopération constructive entre les acteurs privés et les autorités publiques, et non sur la stigmatisation.
S'abonner à notre lettre d'information
Merci !
Vous avez rejoint avec succès notre liste d’abonnés.
Publications complémentaires

Réponse à la consultation de l’ACPR-AMF Fintech sur les Smart Contracts

Newsletter de l’Adan – Mars 2025

Publication du memorandum de l’Adan sur la tokenisation
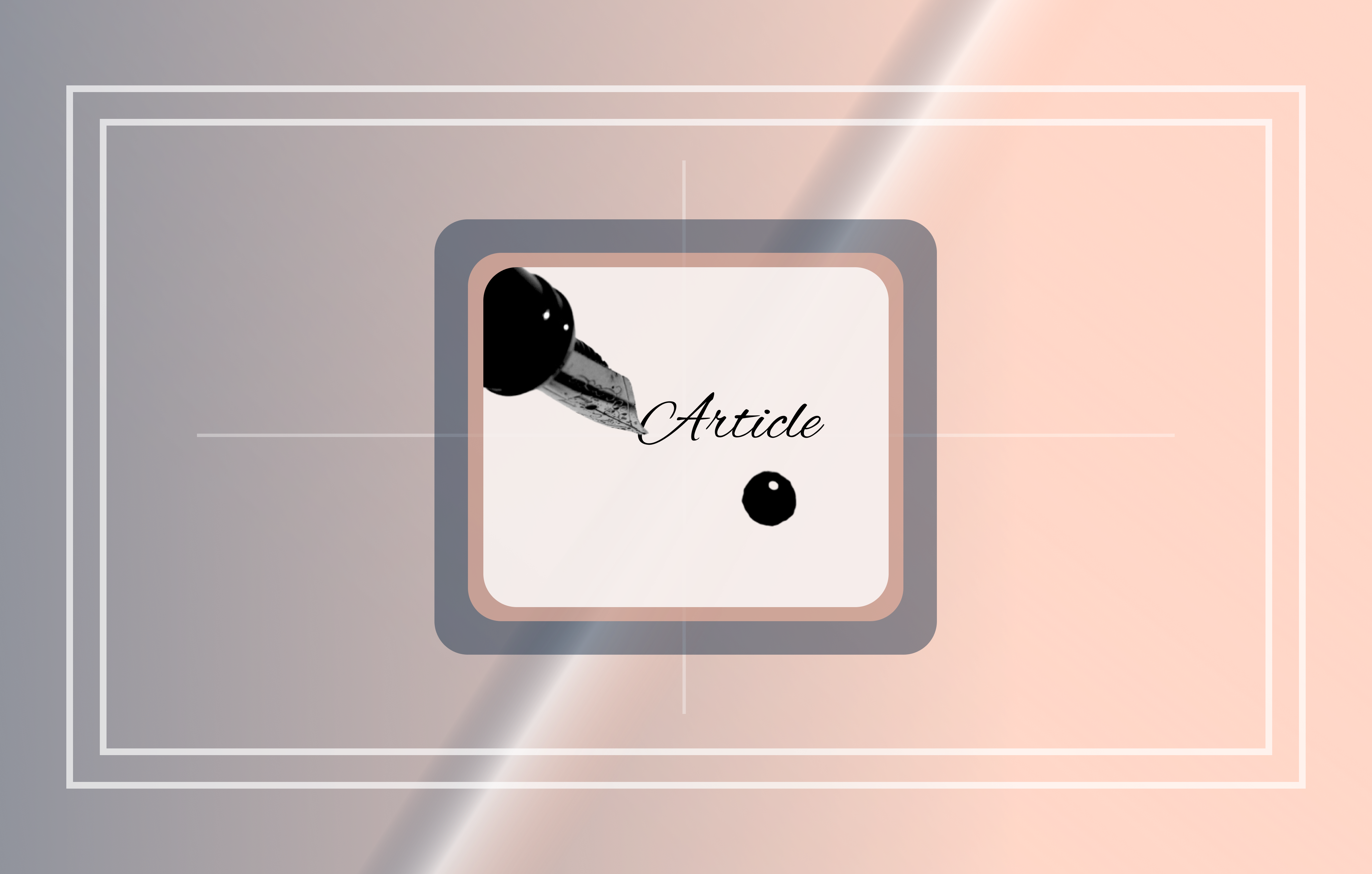
Tribune « Web3/Blockchain sous surveillance : quand la lutte contre le narcotrafic menace l’innovation »

Newsletter de l’Adan – Janvier 2025
